| « La Pologne ne peut
pas seulement apporter de nouveaux marchés à l’U.E.,
mais aussi une expérience historique » ( T.Mazowiecki
- printemps 2004).
 La Pologne existe au sein de l’Europe bien avant son intégration
dans l’U.E. C’est un lieu commun que de l’affirmer.
Pourtant, qui connaît bien les circonstances exactes de son
adhésion, de la « longue marche » vers
l’U.E. depuis son émancipation de 1989 qui l’a
précédé et surtout de ses véritables
aspirations, souvent mal comprises par les opinions des pays membres « plus
anciens » de la communauté ? Les débats
sans fins, les polémiques déroutantes, les déclarations
blessantes même ont, depuis le début du processus
d’adhésion de la Pologne, accompagné sa route
vers la plein reconnaissance qu’elle mérite à l’extérieur
et sa « transformation » volontaire à l’intérieur.D’où viennent
les incompréhensions avec les partenaires, même les
plus sincères, comme la France et ses réticences à l’intérieur ?Les
lignes qui suivent n’ont pas d’autre ambition que de
tenter de donner quelques angles de vue, parmi tant d’autres,
au sujet des difficultés mais aussi des victoires de la
Pologne dans sa route vers l’Union Européenne. De
plus en plus de voix soulignent, d’ailleurs, que la Pologne
est une chance pour l’Union, tout autant que la réciproque,
purement économique. C’est peut être là le
nœud du problème : la Pologne par son histoire
et sa « civilisation » si riches et si complexes
ne pose-t-elle pas la véritable question qui fâche :
qu’en est-il de la construction européenne politique,
au sens premier du terme ? La Pologne existe au sein de l’Europe bien avant son intégration
dans l’U.E. C’est un lieu commun que de l’affirmer.
Pourtant, qui connaît bien les circonstances exactes de son
adhésion, de la « longue marche » vers
l’U.E. depuis son émancipation de 1989 qui l’a
précédé et surtout de ses véritables
aspirations, souvent mal comprises par les opinions des pays membres « plus
anciens » de la communauté ? Les débats
sans fins, les polémiques déroutantes, les déclarations
blessantes même ont, depuis le début du processus
d’adhésion de la Pologne, accompagné sa route
vers la plein reconnaissance qu’elle mérite à l’extérieur
et sa « transformation » volontaire à l’intérieur.D’où viennent
les incompréhensions avec les partenaires, même les
plus sincères, comme la France et ses réticences à l’intérieur ?Les
lignes qui suivent n’ont pas d’autre ambition que de
tenter de donner quelques angles de vue, parmi tant d’autres,
au sujet des difficultés mais aussi des victoires de la
Pologne dans sa route vers l’Union Européenne. De
plus en plus de voix soulignent, d’ailleurs, que la Pologne
est une chance pour l’Union, tout autant que la réciproque,
purement économique. C’est peut être là le
nœud du problème : la Pologne par son histoire
et sa « civilisation » si riches et si complexes
ne pose-t-elle pas la véritable question qui fâche :
qu’en est-il de la construction européenne politique,
au sens premier du terme ?
LE TRAVAIL DE TITAN
 Quelque soit le côté duquel on se place (hors de
Pologne/en Pologne), personne ne conteste la difficulté qui
a consisté (et qui consiste toujours, d’ailleurs,
l’intégration « réglementaire » n’est
pas terminée à proprement parler) pour la jeune République
de Pologne, qui a succédé, en 1989 à la République
populaire, à transformer presque entièrement les
structures d’administration de sa société ainsi
que de réformer, à l’aune des critères
de convergences et des normes et règlements européens,
son système économique, ses « forces vives ».
En simplifiant, la Pologne a dû accomplir en 10 ans ce que
d’autres pays ont progressivement fait évoluer en
40 ans.En effet, même si dès 1990, la Pologne a souhaité intégrer
la C.E.E.(processus lancé officiellement par le programme
PHARE de 1989 et par l’accord d’association Pologne-C.E.E
de décembre 1991),la Pologne ne s’est lancée
dans sa mutation vers la conformité européenne qu’en
1994 (rédaction du livre blanc de la commission européenne,
conditions d’adhésion et candidature officielle).Même
si , par la suite, les termes de l’acceptation du dossier
polonais ont été négociés en prenant
en compte les spécificité du pays, il a fallu intégrer
la législation, la standardisation, les changements structurels
en seulement une décennie. A cet égard, les accords
de Copenhague, présentés comme problématiques
et symptomatiques de la soi-disant « réticence
des futurs nouveaux adhérents »,thèse
largement répandue notamment dans les médias français,
ont constitué un point d’orgue de ses travaux pratiques
imposés. Comme le résume H.Wozniakowski (président
des éditions Znak, membre des instances d’Unia Wolonosci)
,ils ont été le moment le plus tendu et le révélateur
des difficultés à surmonter pour la Pologne, pourtant
déjà, à l’époque, dans la dernière « ligne
droite », leur profonde mue vers les standards européens
de l’U.E. Il faut souligner également comme le prétend
Y.Zlotowski du centre d’études et de recherches internationales
de Paris « que l‘incertitude concernant la date
d’entrée de la Pologne dans l’U.E. est sans
nul doute un instrument de la stratégie de la commission »et
a constitué un élément supplémentaire
de frustration et de doute de la part des polonais dans cette « longue
marche ».En effet, l’agenda 2000 avait fait l’hypothèse
d’une adhésion de six nouveaux membres (Pologne, Hongrie,
République Tchèque, Slovaquie, Slovénie et
Chypre) pour 2002, la commission et le parlement tablant, eux,
sur 2003. La plupart des ministres du gouvernement polonais ayant
approuvé l’agenda 2000, fin 1999, prévoyaient
2002. Lors d’une conférence intergouvernementale,
le ministre des affaires étrangères, Mr B.Geremek,
confronté aux critiques allemandes à propos de la
lenteur du processus, a promis que le pays allait accélérer
les choses et que les atermoiements dans le domaine de l’environnement
ou concernant la loi sur les certifications seraient rapidement
résolus.La commission a alors glissé qu’une
adhésion en 2003 était, dans ce cas, envisageable.
Plus « politique », l’ambassadeur de
l’U.E. à Varsovie a déclaré en juin
1999 qu’il ne fallait pas de l’Europe qu’elle
s’adapte à telle ou telle exigence politique de la
Pologne. Quelque soit le côté duquel on se place (hors de
Pologne/en Pologne), personne ne conteste la difficulté qui
a consisté (et qui consiste toujours, d’ailleurs,
l’intégration « réglementaire » n’est
pas terminée à proprement parler) pour la jeune République
de Pologne, qui a succédé, en 1989 à la République
populaire, à transformer presque entièrement les
structures d’administration de sa société ainsi
que de réformer, à l’aune des critères
de convergences et des normes et règlements européens,
son système économique, ses « forces vives ».
En simplifiant, la Pologne a dû accomplir en 10 ans ce que
d’autres pays ont progressivement fait évoluer en
40 ans.En effet, même si dès 1990, la Pologne a souhaité intégrer
la C.E.E.(processus lancé officiellement par le programme
PHARE de 1989 et par l’accord d’association Pologne-C.E.E
de décembre 1991),la Pologne ne s’est lancée
dans sa mutation vers la conformité européenne qu’en
1994 (rédaction du livre blanc de la commission européenne,
conditions d’adhésion et candidature officielle).Même
si , par la suite, les termes de l’acceptation du dossier
polonais ont été négociés en prenant
en compte les spécificité du pays, il a fallu intégrer
la législation, la standardisation, les changements structurels
en seulement une décennie. A cet égard, les accords
de Copenhague, présentés comme problématiques
et symptomatiques de la soi-disant « réticence
des futurs nouveaux adhérents »,thèse
largement répandue notamment dans les médias français,
ont constitué un point d’orgue de ses travaux pratiques
imposés. Comme le résume H.Wozniakowski (président
des éditions Znak, membre des instances d’Unia Wolonosci)
,ils ont été le moment le plus tendu et le révélateur
des difficultés à surmonter pour la Pologne, pourtant
déjà, à l’époque, dans la dernière « ligne
droite », leur profonde mue vers les standards européens
de l’U.E. Il faut souligner également comme le prétend
Y.Zlotowski du centre d’études et de recherches internationales
de Paris « que l‘incertitude concernant la date
d’entrée de la Pologne dans l’U.E. est sans
nul doute un instrument de la stratégie de la commission »et
a constitué un élément supplémentaire
de frustration et de doute de la part des polonais dans cette « longue
marche ».En effet, l’agenda 2000 avait fait l’hypothèse
d’une adhésion de six nouveaux membres (Pologne, Hongrie,
République Tchèque, Slovaquie, Slovénie et
Chypre) pour 2002, la commission et le parlement tablant, eux,
sur 2003. La plupart des ministres du gouvernement polonais ayant
approuvé l’agenda 2000, fin 1999, prévoyaient
2002. Lors d’une conférence intergouvernementale,
le ministre des affaires étrangères, Mr B.Geremek,
confronté aux critiques allemandes à propos de la
lenteur du processus, a promis que le pays allait accélérer
les choses et que les atermoiements dans le domaine de l’environnement
ou concernant la loi sur les certifications seraient rapidement
résolus.La commission a alors glissé qu’une
adhésion en 2003 était, dans ce cas, envisageable.
Plus « politique », l’ambassadeur de
l’U.E. à Varsovie a déclaré en juin
1999 qu’il ne fallait pas de l’Europe qu’elle
s’adapte à telle ou telle exigence politique de la
Pologne.
 S’il devait y avoir un seul domaine qui focaliserait dans
le même temps l’immense œuvre de changement qui échoit à la
Pologne dans ses propres entrailles, et les craintes que celle-ci
engendre à l’intérieur du pays, ce serait celui
de l’agriculture. L’importance numérique de
la population agricole polonaise(près de 20%) est un fait
connu, comparativement à sa part moyenne en U.E. (qui ne
dépasse pas les 10% de la population active) : alors
même que partout ailleurs en Europe centrale et orientale,
elle a décru à partir de 2000 (Roumanie exceptée),
elle a continué de progresser jusqu’à cette
date en Pologne, pour de nouveau décroître depuis
2000 ( 27% de la population active, dont 80% possèdent moins
de 10 hectares en 2000 ; contre 19% de la population active
en 2005).Chiffre encore plus parlants si on les compare au voisin
tchèque : la part de la population active agricole
y est passée de 9,7% à 5,1% entre 1989 et 2004. Or
si cette population croît jusqu’en 2000 en Pologne,
la part de l'agriculture dans le PIB, elle, décroît
régulièrement depuis 1989 puisqu'elle est passée
de 14,9 % en 1990 à moins de 5,5 % en 2003. En outre, le
revenu paysan moyen est passé d’un facteur 151 en
1989 à un facteur 38 en 2004 et ce malgré les
168 M d’euros reçus entre 2000 et 2004 dans le cadre
du programme SAPARD de l’U.E. puis les subsides des fonds
structurels depuis. Il ne s’agit pas de savoir,ici d’où vient
la principale responsabilité de ce qu’il faut bien
appeler, à long terme, la disparition des paysans polonais :
soit la « philosophie » de la commission
européenne qui a toujours clairement prôné une
agriculture intensive et « industrielle, même
si des aides sont également données dans un sens
contraire à certaines régions ou bien alors la mauvaise
politique des gouvernements successifs polonais dans la répartition
et les priorités de distribution des aides (successivement
PHARE, SAPARD et fonds structurels).Toujours est-il que pour l’opinion
polonaise, le malaise est là ! Il s’accompagne
d’ailleurs d’un véritable clivage dans l’écart
qui se creuse entre la richesse et les revenus des différentes
couches de la population : que vont devenir ces milliers de
paysans à « recycler » ? S’il devait y avoir un seul domaine qui focaliserait dans
le même temps l’immense œuvre de changement qui échoit à la
Pologne dans ses propres entrailles, et les craintes que celle-ci
engendre à l’intérieur du pays, ce serait celui
de l’agriculture. L’importance numérique de
la population agricole polonaise(près de 20%) est un fait
connu, comparativement à sa part moyenne en U.E. (qui ne
dépasse pas les 10% de la population active) : alors
même que partout ailleurs en Europe centrale et orientale,
elle a décru à partir de 2000 (Roumanie exceptée),
elle a continué de progresser jusqu’à cette
date en Pologne, pour de nouveau décroître depuis
2000 ( 27% de la population active, dont 80% possèdent moins
de 10 hectares en 2000 ; contre 19% de la population active
en 2005).Chiffre encore plus parlants si on les compare au voisin
tchèque : la part de la population active agricole
y est passée de 9,7% à 5,1% entre 1989 et 2004. Or
si cette population croît jusqu’en 2000 en Pologne,
la part de l'agriculture dans le PIB, elle, décroît
régulièrement depuis 1989 puisqu'elle est passée
de 14,9 % en 1990 à moins de 5,5 % en 2003. En outre, le
revenu paysan moyen est passé d’un facteur 151 en
1989 à un facteur 38 en 2004 et ce malgré les
168 M d’euros reçus entre 2000 et 2004 dans le cadre
du programme SAPARD de l’U.E. puis les subsides des fonds
structurels depuis. Il ne s’agit pas de savoir,ici d’où vient
la principale responsabilité de ce qu’il faut bien
appeler, à long terme, la disparition des paysans polonais :
soit la « philosophie » de la commission
européenne qui a toujours clairement prôné une
agriculture intensive et « industrielle, même
si des aides sont également données dans un sens
contraire à certaines régions ou bien alors la mauvaise
politique des gouvernements successifs polonais dans la répartition
et les priorités de distribution des aides (successivement
PHARE, SAPARD et fonds structurels).Toujours est-il que pour l’opinion
polonaise, le malaise est là ! Il s’accompagne
d’ailleurs d’un véritable clivage dans l’écart
qui se creuse entre la richesse et les revenus des différentes
couches de la population : que vont devenir ces milliers de
paysans à « recycler » ?
LE DIFFICILE CHEMIN
 Un clivage dans la répartition des richesses entre les
différentes couches de la société s’est
creusé inexorablement depuis 1990, mais le fait qu’il
s’accélère depuis 1999 et que, de manière
concomitante, les chiffres du chômage en Pologne se soient
dramatiquement accrus depuis cette même période (1999 :
10,9%, 2005 : 17,9%), ont fait de plus en plus penser à de
nombreux polonais, que la marche vers l’Union jusqu’en
2004 (ce fameux « respect des critères de convergence »)
puis le début de sa vie à l’intérieur,
furent, véritablement un chemin trop difficile, une pente
qu’il n’aurait peut être pas fallu prendre, du
moins pas de cette manière. Bien sûr, au final, le
polonais ne doute pas de l’intérêt de la Pologne à faire
partie de l’Union, même si son niveau de vie ne croît
que lentement pour l’instant. C’est une grande victoire
de la Pologne dans l’U.E. de ne pas autant douter autant
que cela du « sens de l’histoire »,
malgré les pilules amères (les partis portés
majoritairement au pouvoir depuis 1990 ne sont-ils pas tous « européens » ?). Un clivage dans la répartition des richesses entre les
différentes couches de la société s’est
creusé inexorablement depuis 1990, mais le fait qu’il
s’accélère depuis 1999 et que, de manière
concomitante, les chiffres du chômage en Pologne se soient
dramatiquement accrus depuis cette même période (1999 :
10,9%, 2005 : 17,9%), ont fait de plus en plus penser à de
nombreux polonais, que la marche vers l’Union jusqu’en
2004 (ce fameux « respect des critères de convergence »)
puis le début de sa vie à l’intérieur,
furent, véritablement un chemin trop difficile, une pente
qu’il n’aurait peut être pas fallu prendre, du
moins pas de cette manière. Bien sûr, au final, le
polonais ne doute pas de l’intérêt de la Pologne à faire
partie de l’Union, même si son niveau de vie ne croît
que lentement pour l’instant. C’est une grande victoire
de la Pologne dans l’U.E. de ne pas autant douter autant
que cela du « sens de l’histoire »,
malgré les pilules amères (les partis portés
majoritairement au pouvoir depuis 1990 ne sont-ils pas tous « européens » ?).
De nombreuses voix se font entendre depuis lors, en Pologne, mais
aussi en France, pour souligner que, peut être, ce malaise
passager des polonais réside dans le fait que la construction
et le processus d’intégration ne s’est fait
que sur des critères techniques, comptables, dans la sphère économique,
la Pologne aspirant à autre chose, de plus politique.
Un exemple peut être parmi d’autres : le coût
social des privatisations. La société polonaise n’est
pas prête à entendre l’argument « comptable » de
l’accroissement du niveau de vie global,de l’équilibre
classes sociales, ou plutôt, de leur disparition, mais celui
du statut professionnel, du plein emploi,de la solidarité nationale,
notions plus ambitieuses et vastes, avec lesquelles ils ne font
pas, à tort ou à raison, de lien.
Ce sentiment se fait jour surtout chez les classes ouvrières
de la population polonaise, celles là mêmes qui avaient été à l’origine
du renversement du système communiste polonais de la République
populaire, en 1989. Maria Jarosz, de l’académie polonaise
des sciences souligne, en effet que :
«
Le paradoxe de l’histoire a voulu que la classe, qui a enterré le
Socialisme réel, qui croyait en son rôle dirigeant
et qui s’attendait à recevoir de "son" gouvernement,
dans le cadre du nouveau système politique, ce qui lui était
justement dû, paye les frais les plus lourds pour la transformation
des formes de propriété. Ces frais peuvent être
mesurés objectivement, mais ils sont aussi ressentis subjectivement
comme une injustice en comparaison du passé et par rapport à la
situation de ceux qui bénéficient des avantages du
nouveau système.
Chez les ouvriers, constituant la majeure partie (75%) des employés
d’entreprises, ce sentiment d’injustice est le plus
fort. Il est lié non seulement à des facteurs économiques,
déterminants pour tout individu, mais aussi à l’incompatibilité de
la notion de "rôle dirigeant de la classe ouvrière",
toujours enracinée dans la mentalité collective, à sa
participation décisive au renversement du socialisme réel
- avec le sentiment tout nouveau de sa moindre valeur par rapport
aux autres couches sociales. ("C’est nous qui les avons
portés au pouvoir, et ils nous traitent encore plus mal
que les autres", "... les ouvriers ne comptent plus,
tout ce qui compte c’est la classe moyenne". "...
pour eux les richesses, pour nous la pauvreté et le chômage").
Les ouvriers perçoivent aussi la tendance à déprécier
la valeur du travail honnête et bien fait, au profit de l’esprit
d’entreprise et de débrouillardise qui sont les plus
côtés. Le résultat de ce phénomène
est le sentiment d’injustice sociale, d’impuissance
et d’asservissement. »
La société polonaise réagit maintenant plus
faiblement aux émotions, slogans et symboles. Elle commence à refuser
le programme économique basé sur la nécessité continuelle
de privations, d’autant plus que leur poids est réparti
inégalement. Il est de plus en plus visible que les ouvriers
se révoltent contre une situation se caractérisant
par le fait que la classe moyenne s’enrichit excessivement
et devient provocante par les signes extérieurs de sa richesse,
alors que les appels à la patience et à l’humilité ne
s’adressent qu’aux plus pauvres.
Les données des statistiques nationales, et les chiffres
fournis par différents ministères, institutions et
organismes de recherche montrent qu’on assiste à un
phénomène de stratification de la société et à sa
paupérisation. L’élément de base de
cette situation est la progression du chômage. Il est perçu
comme la menace la plus grave : au printemps 1992, une partie
des salariés des entreprises nationales sont prêts à consentir
des baisses drastiques de salaire afin d’éviter à tout
prix des réductions d’emploi.
Pour en revenir au processus d’intégration européenne
proprement dit, l’opinion publique polonaise, mais aussi
sa classe dirigeante au plus haut niveau, tous partis confondus,
ont très mal ressenti ce qui a été appelé comme
un « mal nécessaire », le marchandage
de l’adhésion.
Un témoignage intéressant peut nous être donné encore
par Mr H.Wozniakowski :
«
En février 2004, plus de 60% de la population polonaise
déclare nettement sa volonté d’intégrer
l’UE. 22 à 23% sont résolument opposés.
Ces résultats – un peu moins bons qu’au moment
du référendum – résultent de la légitimité en
baisse du gouvernement. Plusieurs partis d’extrême
droite – dont la Ligue des familles polonaises - , Loi et
justice, et un parti de type poujadiste appelé Samoobrona
(Autodefense) produisent un discours très critique à l’égard
des institutions communautaires. La position du gouvernement
de L. Miller a été encore amoindrie par les négociations
avec l’UE. Les négociations de Copenhague (2002) ont été présentées
comme un marchandage à la fois détaillé et
rude. Reste que l’Europe de Jean Monnet et de Robert Schumann
a disparu derrière des questions de quotas et de périodes
transitoires. Les aspects techniques ont caché l’idée
européenne de solidarité au service d’un espace
de coopération et de paix. Le sommet de Copenhague a été présenté comme
le combat de la Pologne contre les membres de l’UE15 et non
comme la construction d’un espace de connivence. Tous les
partis politiques polonais se sont inscrits dans cette perspective
conflictuelle. Résultat, le public a perçu ces négociations
comme mettant en jeu l’intérêt national contre
l’UE. Les rares voix exprimant une autre sensibilité ont été peu
entendues. Les pays candidats comme les pays déjà membres
ont tous une part de responsabilité ».
Là encore, c’est une très grande victoire de
la Pologne que de continuer à surmonter ces freins pour
continuer sur ce chemin difficile de l’existence et de son
affirmation dans l’union européenne, qu’elle
soit de nature seulement économique ou plus largement, politique,
donc.
LA POLOGNE, CHANCE POUR L’EUROPE
 Si la Pologne devait emmener quelque chose à l’Union
européenne en dehors de ces nombreux et nouveaux marchés,
il faudrait chercher sans aucun doute dans certaines de ses aspirations
qui n’ont pas été prises en compte dans son
processus d’intégration, mais que l’union politique
aurait un grand profit à examiner de prés. Si la Pologne devait emmener quelque chose à l’Union
européenne en dehors de ces nombreux et nouveaux marchés,
il faudrait chercher sans aucun doute dans certaines de ses aspirations
qui n’ont pas été prises en compte dans son
processus d’intégration, mais que l’union politique
aurait un grand profit à examiner de prés.
Un certain sens des responsabilités et une cohérence
du peuple polonais vis-à-vis du projet européen.Si
la situation politique intérieure de la Pologne penche volontiers
vers l’agitation et quelquefois l’instabilité,
les polonais n’oublient pas que l’Union Européenne
n’est pas qu’un ensemble de pays coopérants,
mais qu’elle a pour ambition l’unification des peuples
d’Europe au sein d’une même communauté de
vie, sous tous ses aspects.Si de France, le premier Mai 2004 a
souvent été perçu (il y a des exceptions)
comme la date de l’intégration « à l’Europe
de dix « nouveaux » pays », de
Pologne, on y a mis plus de signification historique et politique :
il s’agissait, rien de moins que de la réunification
de l’Europe qui pouvait respirer enfin de ces « deux
poumons » (pour reprendre l’expression de Jean-Paul
II). Ainsi, En ratifiant le projet de traité de constitution
européenne, malgré une opinion très partagée
(les sondages de l’ensemble de l’année 2004,
année charnière, ont balancé très prés
de la ligne rouge du rejet du projet européen actuel, il
faut rappeler que le projet d’intégration ne recueillait
que 55% dans la plupart des sondages des années 1999 et
2000) et l’entrée à la Sejm, assez massive
de « Loi et Justice » et « Ligue
des Familles de Pologne », moins importante pour « Autodéfense » au
cours des dernières années, partis ouvertement opposés
au processus en cours à l’époque d’intégration
dans l’Union Européenne, (avec des nuances notables
tout de même, qui va du retrait pur et simple à la
renégociation ), la Pologne a sauvé l’essentiel
et s’est montrée, de ce point de vue, plus engagée
vis-à-vis de l’Europe que nombre de pays voisins,
alors qu’on lui reprochait une attitude négative.
La Pologne est un pays à tradition démocratique ou
du moins participative très ancienne, même sous les
monarchies qui étaient électives dès le 16ème
siècle. Rappelons que si la Pologne a été la
grande puissance européenne du 16ème siècle,
celle-ci ne s’est pas bâtie comme un empire de conquêtes
militaires, mais par assimilation de peuples d’ethnies et
de religions différentes et par « mariage » confédéral
avec le grand voisin balto-ruthène pour former la république
des deux nations avec le grand duché de Lituanie, exemple
unique dans l’histoire européenne d’une entité bicéphale
et homogène. Les rois de Pologne, depuis cette période
jusqu’à leur dernier, en 1793, étaient élus
par une assemblée, certes d’aristocrates, mais il
s’agissait bien d’une assemblée élective
qui fonctionnait sur le modèle de la représentativité.
La première grande constitution inspirée de la révolution
française était une constitution polonaise, celle
du 3 mai 1791 (fête nationale du pays) libérale et équilibrée,
qui laissait sa place à tous les peuples du royaume.
La Pologne a longtemps présenté avec bonheur le visage
d’une Société multiculturelle et ouverte, jusqu’à la
catastrophe de la seconde guerre mondiale. Là également,
c’est une tradition millénaire du pays. Songeons que,
si la Pologne actuelle est homogène en terme de population
polonophone et catholique (à plus de 97%), la plus grande
période de l’histoire du pays a vu vivre sous la couronne,
puis la république de nombreuses nationalités qui,
chacune, se voyait automatiquement octroyer les mêmes droits.
L’éminent slaviste, l’historien britannique
Norman Davies parle de la Pologne du 15ème au 19ème
, sans hésiter, comme « d’un miracle permanent
et d’un melting polt sublime et enrichissant, unique au monde,
peut être la civilisation moderne la plus équilibrée
et tempérée qui fût ». En 1939,
la Pologne comptait pour prés de 10% de sa population des
citoyens orthodoxes (biélorusses et ukrainiens), pour 15%
des ukrainiens catholiques-grecs (les uniates) et pour plus de
10%, des juifs. Ces derniers ont développé la plus
belle partie de leur riche culture au sein de cette Pologne. Marek
Alter parle de « Pologne juive, de juifs de Pologne,
d’un peuple qui, nulle part ailleurs qu’en Pologne
n’aurait pu s’épanouir et se rendre éternel à la
mémoire, lié à cette terre autant qu’à Canaan ».
Dés Kazimierz Wielki "le Grand" (roi de 1333 à 1370),
les juifs ont trouvé en Pologne un refuge et une charte
leur garantissant une citoyenneté à part entière,
alors que partout ailleurs en Europe, ils n’étaient
pas les bienvenus. Il faut ajouter à cet héritage
historique peu connu à l’extérieur de la Pologne,
une ouverture vers la France qui dépasse la simple nostalgie
pour Napoléon Ier ou le maréchal Weygand, au temps
ou la France se battait aux côtés des polonais pour
sauver leur liberté. Les liens entre la France et la Pologne
ont été le sujet de nombreuses thèses, études,
ouvrages entiers qui n’ont pas encore épuisé le
sujet. Un lien très fort, de l’ordre peut être
de l’insondable a toujours uni les deux pays. Nous ne donnerons
qu’un seul exemple de la persistance de se sentiment chez
les polonais de l’an 2005, alors qu’on parle pourtant
de la généralisation de la culture et du mode de
vie anglo-saxon en Pologne :62% des polonais souhaiteraient
apprendre le français s’ils avaient le choix d’une
seule langue étrangère…(Enquête de l’Université de
Lodz, sciences sociales, 2004).
La société polonaise est éduquée et
responsable, le niveau moyen d’enseignement reste élevé,
avec une forte connaissance de sa propre histoire. Il ne s’agit
pas d’affirmer que le polonais moyen est plus intelligent
et capable de grandes choses que les autres, mais bien de souligner
que, peut être est-ce une leçon de l’histoire
de ce peuple héroïque qui a toujours ressuscité des
pires malheurs, le polonais de la rue, même parmi les générations
les plus jeunes, possède des connaissances remarquables,
suffisamment, ergoterons-nous, pour donner son avis sur tout et
contredire son voisin sur n’importe quel sujet, de la Philosophie
grecque, à la meilleure méthode de brasserie. De
là, peut être aussi, la difficulté de ce pays
a acquérir un gouvernement stable…J’ai été personnellement
frappé d’être le témoin de la récitation
par cœur de plusieurs pages prises au hasard dans les 350
que compte « Pan Tadeusz » (le grand poème
national en vers d’A.Mickiewicz, écrit en exil en
1834 alors que la Pologne n’existait plus, une des grandes
références littéraires et historique du pays)
sans aucune faute, par mes deux beaux parents, qui n’avaient
pourtant jamais fait d’études de lettres…Cette
richesse là ne serait-elle pas également précieuse
pour l’union ?
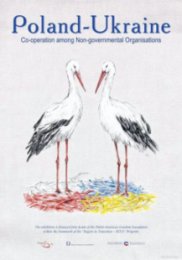 La société polonaise est solidaire. Les polonais
sont solidaires entre « eux » et envers les
autres (soulignons, par exemple, le rôle d’action humanitaire
irremplaçable de l’AHP à travers le monde).C’est également
une banalité que d’énoncer cela, alors que
le principal mouvement politique connu à l’étranger
de Pologne est le syndicat « Solidarnosc ».
Mais alors que la solidarité est justement une des notions
fondatrices du traité de Rome (inscrite dans son préambule),
ce qui vient « d’en bas », de ce peuple
lui même depuis si longtemps confronté aux épreuves
( le néant de la disparition de la nation, l’enfer
de la dernière guerre, pour laquelle la Pologne a eu plus
de victimes que tout autre pays, et le douloureux purgatoire de
la république populaire, voilà le 20ème siécle
de la Pologne, juste interrompu par les vingt ans de l ‘éphémère
république de l’entre deux guerres,constamment sous
la menace de l’anéantissement) et qui, donc, rejoint
les aspirations des pères fondateurs de l’union, est
un bien inestimable pour tous les membres de cette communauté. La société polonaise est solidaire. Les polonais
sont solidaires entre « eux » et envers les
autres (soulignons, par exemple, le rôle d’action humanitaire
irremplaçable de l’AHP à travers le monde).C’est également
une banalité que d’énoncer cela, alors que
le principal mouvement politique connu à l’étranger
de Pologne est le syndicat « Solidarnosc ».
Mais alors que la solidarité est justement une des notions
fondatrices du traité de Rome (inscrite dans son préambule),
ce qui vient « d’en bas », de ce peuple
lui même depuis si longtemps confronté aux épreuves
( le néant de la disparition de la nation, l’enfer
de la dernière guerre, pour laquelle la Pologne a eu plus
de victimes que tout autre pays, et le douloureux purgatoire de
la république populaire, voilà le 20ème siécle
de la Pologne, juste interrompu par les vingt ans de l ‘éphémère
république de l’entre deux guerres,constamment sous
la menace de l’anéantissement) et qui, donc, rejoint
les aspirations des pères fondateurs de l’union, est
un bien inestimable pour tous les membres de cette communauté.
La Pologne possède une culture de négociation et
de concorde, très récemment éprouvées
lors des épisodes fondateurs de la nouvelle démocratie
polonaise : les accords de Gdansk suivis par la table ronde « constituante »de
1989. Cette capacité à « faire la paix », à,
pacifiquement et de manière aussi éclatante aux yeux
du monde, tirer les leçons du passé, entre polonais
et décider d’un avenir commun, même si tout
n’a pas été rose, alors que le pays se trouvait
au centre de toutes les turbulences de la fin du siècle
dernier est remarquable. Elle est surtout la démonstration
d’une certaine sagesse de la société polonaise
et de son homogénéité, car tout est venu « d’en
bas », encore une fois. Loin sera la tentation de la
croire immature devant les grandes questions qui l’engagent
et qui, désormais, engagent l’Union avec elle. Le
pays, à travers ses dirigeants a d’ailleurs prouvé,
au cours de la toute dernière phase de négociation à l’adhésion,
qu’il n’était pas figé sur des schémas
immuables et qu’il acceptait le compromis et pas seulement
sur des questions techniques et économiques (période
transitoire exigée avant la libre circulation des travailleurs
polonais), mais aussi au sujet de problématiques plus fondamentales
(renoncement aux références chrétiennes dans
la constitution, qui n’était pas d’ailleurs
demandées par la seule Pologne).
 Enfin, la Pologne peut emmener une vision nouvelle de la conception
de la civilisation européenne au sens large, en partie grâce à son
expérience historique unique,assez étrangère,
malheureusement, aux autres pays de l’U.E., et surtout à ses
pays fondateurs. Un exemple d’approche enrichissante, sous
un angle historique inédit, réside dans la position
de l’opinion polonaise au sujet de l’intégration
de la Turquie dans l’U.E. Un sondage de l’institut
CBOS de Janvier 2005 révélait que 68% des polonais étaient
favorables à l’intégration de la Turquie dans
l’Union Européenne. Les polonais sont encore très
marqués par l’attitude de l’empire ottoman,
qu’ils ont pourtant combattu un siècle auparavant,
guerre dont le point culminant fut la contribution décisive
de l’armée polonaise à sauver Vienne de la
prise turque (1683, Roi Jan Sobieski), qui a été la
seule nation européenne à ne pas reconnaître
le 3ème et dernier partage de la Pologne en 1795, et sa
disparition pure et simple des cartes du monde jusqu’en 1918.
Ils en ont gardé une attitude plus nuancée envers
la Turquie actuelle, sa descendante. Il se transmet d’ailleurs
de père en fils cette histoire vraie du protocole d’audience
des ambassadeurs auprès du grand vizir au 19ème siècle, à Istanbul
où, lorsque le tour venait à l’ambassadeur
du « Lechistan » (nom turque de la Pologne)
de se présenter, forcément absent, son pays n’existant
plus, le chef du protocole répondait invariablement, chaque
année au grand Vizir, interrogatif « Mr L’ambassadeur
du Lechistan s’excuse, il est juste retardé… ».
Là encore, l’esprit de concorde et de réconciliation
des polonais est plus surprenant que ce que l’on pourrait
penser : surmonter les rancoeurs pour construire ensemble,
malgré les conflits du passé, les polonais ont fait
cette expérience plus que tout autre peuple de l’union.
Il y a de cela aussi, des choses à apprendre de la Pologne.
Ajoutons que les polonais sont encore plus favorables à une
entrée rapide de leur voisin Ukrainien au sein de l’Union.
Ce même sondage donne une opinion favorable à 84%.Pour
un pays très souvent en conflit avec la Pologne mais bel
et bien cousin historiquement et dont nombre de ressortissants
des deux côtés de la frontière sont issus du
même berceau, se voir « appelé » de
manière aussi massive et favorable, du moins dans le cadre
de ce sondage, est un autre signe de réconciliation particulièrement
impressionnant. L’appui de la Pologne à la « révolution
orange » de Kiiv en est le point d’orgue de ces
dernières années. L’ouverture d’un cimetière
militaire commun aux combattants des deux nations, qui n’en
ont fait qu’une durant plusieurs siècles, dans la
superbe ville de Lviv (Lwow en polonais) en donne tout l’esprit,
celui de cette sagesse et de cette vision « civilisationnelle » et
non pas seulement économique de notre Europe par la Pologne ;
toutes choses dont les peuples et dirigeants fondateurs de l’Union
semblent dépourvus, atteints de cette cécité qui
pourrait être la véritable origine de la crise de
l’Union. Enfin, la Pologne peut emmener une vision nouvelle de la conception
de la civilisation européenne au sens large, en partie grâce à son
expérience historique unique,assez étrangère,
malheureusement, aux autres pays de l’U.E., et surtout à ses
pays fondateurs. Un exemple d’approche enrichissante, sous
un angle historique inédit, réside dans la position
de l’opinion polonaise au sujet de l’intégration
de la Turquie dans l’U.E. Un sondage de l’institut
CBOS de Janvier 2005 révélait que 68% des polonais étaient
favorables à l’intégration de la Turquie dans
l’Union Européenne. Les polonais sont encore très
marqués par l’attitude de l’empire ottoman,
qu’ils ont pourtant combattu un siècle auparavant,
guerre dont le point culminant fut la contribution décisive
de l’armée polonaise à sauver Vienne de la
prise turque (1683, Roi Jan Sobieski), qui a été la
seule nation européenne à ne pas reconnaître
le 3ème et dernier partage de la Pologne en 1795, et sa
disparition pure et simple des cartes du monde jusqu’en 1918.
Ils en ont gardé une attitude plus nuancée envers
la Turquie actuelle, sa descendante. Il se transmet d’ailleurs
de père en fils cette histoire vraie du protocole d’audience
des ambassadeurs auprès du grand vizir au 19ème siècle, à Istanbul
où, lorsque le tour venait à l’ambassadeur
du « Lechistan » (nom turque de la Pologne)
de se présenter, forcément absent, son pays n’existant
plus, le chef du protocole répondait invariablement, chaque
année au grand Vizir, interrogatif « Mr L’ambassadeur
du Lechistan s’excuse, il est juste retardé… ».
Là encore, l’esprit de concorde et de réconciliation
des polonais est plus surprenant que ce que l’on pourrait
penser : surmonter les rancoeurs pour construire ensemble,
malgré les conflits du passé, les polonais ont fait
cette expérience plus que tout autre peuple de l’union.
Il y a de cela aussi, des choses à apprendre de la Pologne.
Ajoutons que les polonais sont encore plus favorables à une
entrée rapide de leur voisin Ukrainien au sein de l’Union.
Ce même sondage donne une opinion favorable à 84%.Pour
un pays très souvent en conflit avec la Pologne mais bel
et bien cousin historiquement et dont nombre de ressortissants
des deux côtés de la frontière sont issus du
même berceau, se voir « appelé » de
manière aussi massive et favorable, du moins dans le cadre
de ce sondage, est un autre signe de réconciliation particulièrement
impressionnant. L’appui de la Pologne à la « révolution
orange » de Kiiv en est le point d’orgue de ces
dernières années. L’ouverture d’un cimetière
militaire commun aux combattants des deux nations, qui n’en
ont fait qu’une durant plusieurs siècles, dans la
superbe ville de Lviv (Lwow en polonais) en donne tout l’esprit,
celui de cette sagesse et de cette vision « civilisationnelle » et
non pas seulement économique de notre Europe par la Pologne ;
toutes choses dont les peuples et dirigeants fondateurs de l’Union
semblent dépourvus, atteints de cette cécité qui
pourrait être la véritable origine de la crise de
l’Union.
EN GUISE DE CONCLUSION
 « La Pologne, elle, sait qu'elle est un facteur de
paix et de stabilité en Europe et veut que l'on compte avec
elle. D'où l'importance du Triangle de Weimar qu'on ne devrait
pas traiter comme une coquille vide (France-Allemagne-Pologne,
ndt). » T.Mazowiecki. « La Pologne, elle, sait qu'elle est un facteur de
paix et de stabilité en Europe et veut que l'on compte avec
elle. D'où l'importance du Triangle de Weimar qu'on ne devrait
pas traiter comme une coquille vide (France-Allemagne-Pologne,
ndt). » T.Mazowiecki.
En laissant de côté les critères purement économiques,
et si la Pologne contribuait à sauver l’idée
européenne, dans le sens de sa civilisation ?
B.Glénat – Juillet 2005.
|
![]()

